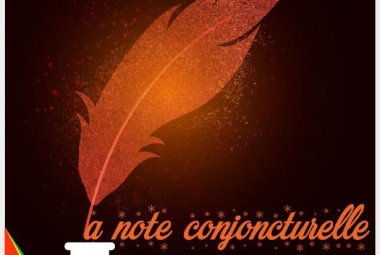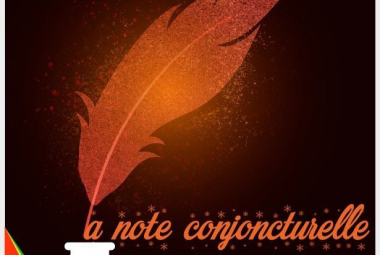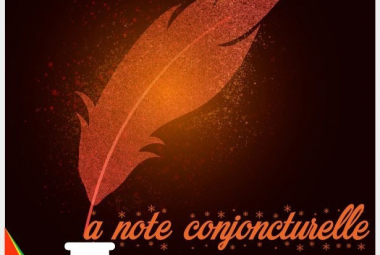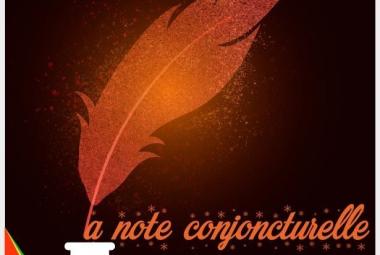Obnubilé par son rang au classement Doing business, le gouvernement burkinabè semble perdre de vue la nécessité de concilier investissements économiques et équilibre des territoires, deux impératifs indispensables au développement harmonieux du pays au moment où l’unité nationale bat de l’aile.
En prenant fonction début février comme ministre de l’Industrie, Harouna Kaboré était loin de s’imaginer que sa première semaine serait aussi mouvementée par ce qui, à première vue, paraissait pourtant comme une entrée sous se bonnes auspices. Alors que la tendance est plutôt à la fermeture des unités industrielles au Burkina Faso, l’annonce par le turc Ayka Addis Textile & Investment de l’ouverture prochaine d’une usine ne pouvait pas si bien tomber. Qui plus est, une usine de transformation de coton, produit pour lequel, malgré une campagne ratée en 2017, le Burkina reste l’un des plus gros productueurs africains. Le projet est gigantesque, 220 milliards de francs CFA, à la clé des promesses de plus de 50.000 emplois créés.
Un seul élément viendra pourtant entacher cette annonce mirifique au point d’en faire une grosse polémique: le lieu d’implantation de la future usine. Ouagadougou. La capitale qui concentre déjà tout et dont la zone industrielle est saturée. Ouagadougou sans eau. Ouagadougou sans électricité. Pis, à Ouagadougou et dans sa région, on ne produit aucun fil de coton...
Répli identitaire ?
Il n’en a pas fallu plus pour réveiller chez certains de vieilles rancoeurs mal enfouies. D’abord les chefs coutumiers de Koudougou, désabusés que le gouvernement abandonne, selon eux, sa promesse de remettre sur le métier à tisser Faso Fani. Puis, le tour à une lugubre organisation d’en rajouter à la couche nauséeuse, au nom d’un prétendu Grand Ouest. Au Président Kaboré, tous ont égréné un chapelet de récriminations victimaires, reprochant au pouvoir ses choix électoralistes sur fond de préférence régionaliste.
Aussi loufoques qu’extrapolées, toutes ces déclarations ne contiennent pas moins une once de vérité. Celle d’un État burkinabè historiquement injuste vis à vis de toutes ses composantes. Mais aussi et surtout la vérité d’un État désormais plus enclin à renoncer à sa responsabilité dans la détermination des enjeux stratégiques du pays depuis que ce dernier a opté pour l’économie de marché.
Début avril, devant la représentation nationale, lors de son discours sur l’état de la Nation, le premier ministre Paul Kaba Thiéba a donné les raisons du choix de Ouagadougou pour abriter l’usine. Son gouvernement n’en est nullement responsable. Tout est de la faute des Turcs : « Ils sont venus chez nous, ils ont dit on va faire une étude. L’étude a montré que le meilleur endroit pour installer l’usine était Ouagadougou. Pourquoi ? Parce que comme c’est destiné à l’exportation, il faut que l’aviation soit proche, il faut que l’aéroport soit proche. Si vous allez l’installer ailleurs, vous augmentez les coûts de production. Il faut également que l’énergie à haute tension soit proche. Je sais pas, je ne suis pas rentré dans le fond du dossier, mais c’est ce que j’ai vu. Donc l’opérateur industriel qui est venu a dit que « ha je peux faire installer mon usine ici ». Ce sont des étrangers qui viennent pour s’installer ici, et ils ont leur modèle. Est-ce qu’on peut s’insérer dans leur modèle ? Si on veut changer leur modèle de projet, ils vont partir. »
Mieux d’État
Au-delà de ces explications peu convaincantes prêtées à l’investisseur, il reste que l’État burkinabè devra se regarder en face et indiquer clairement quels sont les déterminants des choix des sites abritant les grandes unités économiques? De tels choix peuvent-ils se passer de déterminants politiques ? À l’évidence non. Et ce n’est pas grave. La logique politique au sens strict n'est mauvaise en soi si tant est qu’il s'agisse de poursuivre des objectifs nobles. Le drame ce serait plutôt de confondre logique politique et visée électoraliste.
Dans un pays comme le nôtre en proie aux appétits les plus sordides, l'équilibre des territoires en plus de relever d'une nécessité économique de diversification des zones de production est une exigence de justice sociale et de consolidation de la Nation. En ce sens, c'est un choix politique stratégique et non le résulat d'un vil calcul politicien. Pour en saisir la portée et les enjeux, il faut pour beaucoup et pas seulement que les gouvernants actuels, faire preuve d'une hauteur de vue et d'une capacité pointue d'obervation et d'interprétation des signes d'un monde en changement.
Et cette tâche n’incombe pas à l’investisseur privé. C’est la mission première de l’État de rendre le Burkina Faso attractif. Aurait-il été vraiment soucieux d'un quelconque équilibre des territoires, que rien ne coûtait au gouvernant de remettre par exemple l'aéroport de Bobo-Dioulasso à niveau et, pas seulement pour les besoins de la seule usine textile mais dans une perspective de rédynamisation du bassin industriel de cette région. C’est en assumant cette responsabilité que l'État peut amener un investisseur, national ou étranger, à oeuvrer dans le sens qui est politiquement bon pour lui. À défaut, le gouvernement de Paul Kaba Thiéba se complaît dans une incantation fétichiste inopérante. Car, la magie de la formule « investissements structurants » prononcée à longeur de discours ne fonctionne vraiment que par les actes.
Boureima Salouka