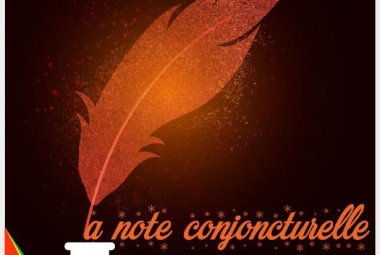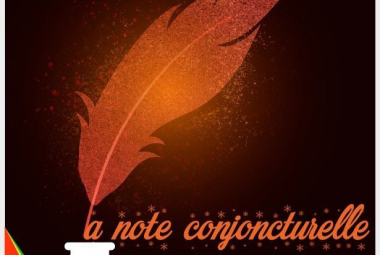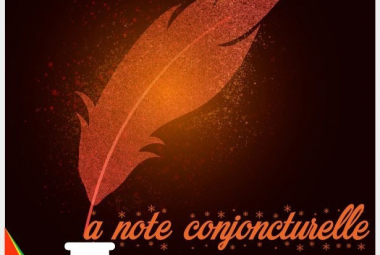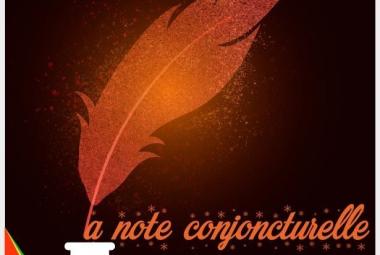Burkina Faso : Se réveiller ou périr !
Les Burkinabè se le refusent, pourtant ils devront bien se rendre à l’évidence. Leur pays n’est plus une terre de sécurité. Au-delà des jérémiades et des accusations, la société burkinabè toute entière, à commencer par le pouvoir de Ouagadougou, devra bander des muscles et des neurones pour faire face à la guerre qui lui est imposée.
Même pas un deuil national de décrété. Même pas un drapeau en berne. Seule une timide initiative de citoyens appelant à une marche silencieuse avortée. Sinon rien. Absolument rien. Comme si de rien n’était. Cette fois-ci, face à la gifle que leur a administrée les terroristes, les Burkinabè se la jouent tranquille sur un faux air d’insouciance qui cependant cache mal une gêne et une hantise profondes.
Un attentat au sein de l’État-major de leur armée. En pleine journée. Alors que devrait s’y tenir une réunion à laquelle toutes les têtes pensantes du système de défense du pays étaient invitées… De peu, les terroristes ont manqué de décapiter l’armée burkinabè.
En frappant le Burkina Faso en plein cœur de son système de défense, les terroristes ou ceux qui sont présentés comme tels ont enfin porté au grand jour le fond de leur message que le pouvoir de Ouaga peinait à décoder : c’est la guerre déclarée.
Déjà, dès le mois d’août 2017, ils en avaient donné les preuves irréfutables, quand ils avaient commencé à poser des mines anti personnelles dans le sahel burkinabè. Mais ça c’était dans le Sahel, ce n’était pas encore le Burkina Faso qui, pour beaucoup n’a d’existence que par la seule capitale, Ouagadougou.
Les attentats du vendredi 2 mars soulèvent bien de questions qui, cette fois-ci, outrepassent les incompréhensions ordinaires quant aux motivations des terroristes pour renvoyer à la face et à la conscience des Burkinabè les raisons profondes de leur criante incapacité collective à se défendre eux-mêmes. Par la prévention. Par la riposte adéquate. Par le traitement judiciaire conséquent. Sans complaisance. Sans faux-fuyants.
S’assumer une fois pour toutes !
Que faisons-nous pour nous défendre et pour préserver l’intégrité de notre territoire en tant qu’espace géographique et en tant que communauté de destin ? Alors qu’une cinquième colonne s’est constituée au sein de son armée et en dehors, l’ensemble de la société burkinabè peut-elle continuer à se complaire dans sa vie du déni et à reléguer au stade de futilité la question de la gouvernance sécuritaire par son désintérêt ? Que font les syndicalistes, les OSC, les leaders religieux, traditionnels, les intellectuels, les politiques, les jeunes, etc. ? Peut-on et doit laisser cet enjeu majeur aux seuls soins des professionnels des armes et du gouvernement actuel ?
Délibérer et agir par l’intelligence collective pour la survie et pour la perpétuation historique de son pays ne sont en rien un ralliement à un quelconque pouvoir en place. Bien au contraire. C’est plutôt cette impression de dépit doublée d’une attitude de résignation fataliste qui est dangereuse. Elle est celle de la victime expiatoire qui, sans se battre, se livre à l’ennemi mains et pieds liés.
Pour n’avoir pas pris les bonnes décisions à temps, le Burkina se découvre pris au dépourvu, obligé dans un espace temps réduit, de faire plusieurs tâches concomitamment. Réformer l’armée, rendre opérationnels ses renseignements, équiper ses troupes, former ses soldats, engager ses fils et filles dans la défense de son territoire,à tous les niveaux.
Il y a aujourd’hui au Burkina Faso, pour reprendre le terme du Dr Ra-Sablga Ouédraogo de l’Institut Free Afrik, une « rupture dans la générosité de la jeunesse. » Moins de 24 heures après la terrible attaque, des jeunes burkinabè festoyaient en ville. Tranquilles. En démissionnant du gouvernement en août dernier, Tahirou Barry, alors ministre de la Culture, avait eu ces paroles graves à l’endroit du chef de l’État : « Roch Marc Christian Kaboré ? Il semble profondément endormi au milieu d’un feu de brousse. » En réalité, Tahirou ne parlait pas que du Président. Il s’adressait aussi au Burkina Faso et aux Burkinabè, endormis qu’ils sont, en plein incendie.
Boureima Salouk