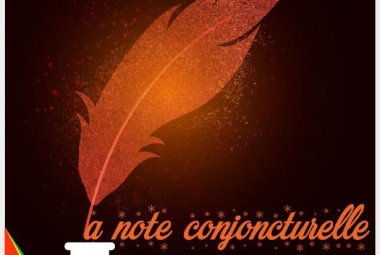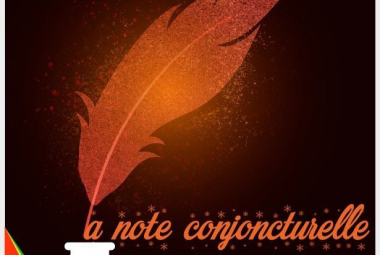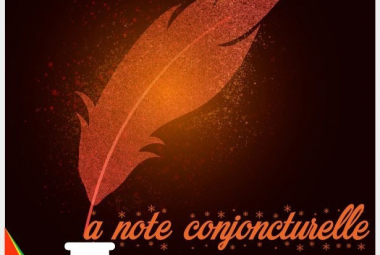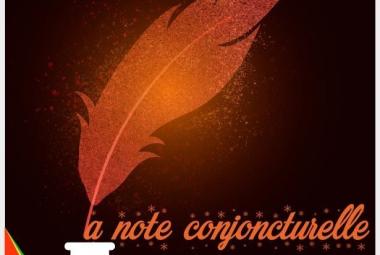N°01_Juin 2017
Burkina Faso : La réconciliation, c’est encore loin ?
Il s’agit d’une urgence sans cesse remise aux calendes grècques. Pourtant tous sont unanimes ou presque sur la nécessité de réinventer un vivre ensemble nouveau tant le Burkina va mal. Et chaque jour, l’actualité brûlante du pays nous le rappelle. Violemment.
La dernière a eu lieu à Manga, dans le Centre-Sud. Au prétexte qu’un des leurs a été arbitrairement placé sous les verrous alors qu’il a eu une incartade avec un garde pénitentiaire, la population a saccagé le palais de justice. Des attaques ciblées du genre, on en compte à foison. Des ménaces aussi. La plus effroyable a été proférée par les membres du Cadre de concertation des organisations de la société civile (CNOSC) en mai 2016. S’insurgeant contre les libertés provisioires accordées à des membres de l’ancien pouvoir alors sous mandat de dépôt, ils promettaient incendier le palais de justice de Ouagadougou.
Ces actes traduisent une dégradation avancée des rapports entre justice et population. Au sentiment de méfiance s’est substituée une attitude de défiance de l’institution judiciaire dont les procédures et le langage restent ésotériques chez nombre de citoyens. Poussée à l’extrême, cette défiance a donné lieu à un phénomène des plus pernicieux pour la pérennité l’État lui-même : la justice populaire. Elle a un visage protéiforme, pouvant tantôt s’incarner dans la vindicte populaire (menée par des badauds contre une femme accusée à tort de trafic d’enfant) ; tantôt elle s’incarne et là dans sa forme achevée, aux milices Koglwéogo. Créés pour suppléer les carrences sécuritaires de l’État à l’intérieur du pays, ces groupes d’autodéfence, du fait leurs exactions répétées, sont en passe de mettre en péril l’unité nationale dans un pays pluriethnique. Le chemin de l’enfer, c’est connu, est pavé de bonnes intentions.
Grand corps malade
Décriée, humiliée, pourtant, à plusieurs reprises on s’est penché sur la justice burkinabè. La dernière thérapie de choc a été proposée fin mars 2015 par la Transition qui a prescrit au grand corps malade 114 recommandations consignées dans un pacte pour le renouveau de la justice, en insistant sur l’indépendance de la justice vis à vis du politique.
Malgré cette séparation affirmée, la justice burkinabè, doit prouver qu’elle s’est réellement émancipée de la tutelle politique d’autant plus que dans son architecture elle conserve encore des tribunaux surrannés qui le discréditent. Il s’agit de la Haute cour de justcice et du Tribunal militaire, perçus comme des juridictions d’exceptions et politiques. Du reste, de nombreux observateurs voient l’ingérence politique dans la conduite de deux dossiers emblématiques en cours : celui sur le putsch militaire de septembre 2015 et celui du dernier gouvernement de Blaise Compaoré.
À côté de ces dossiers d’actualité, il y a ceux encore brûlants relatifs aux assassinats de Thomas Sankara et de Norbert Zongo, sur lesquels la justice est attendue. Au-delà de ces affaires fortement politisées et médiatisées, la justice burkinabè devra repenser ses rapports avec le petit peuple, convaincu qu’elle n’existe que pour les plus forts.
HCRUN en crise, Coder incomprise
Si la justice est toujours à la recherche de ses marques, le chantier de la reconciliation qui lui est consubstancielle, lui est en quête d’un architecte. Érigé en janvier 2016, le Haut conseil pour la réconciliation nationale qui est censé, selon sa lettre de mission, « solder le lourd passif de notre histoire commune», peine à se donner une ligne de conduite. Pire, il est miné par des dissensions internes au point de se discréditer, sèmant le doute sur ses capacités réelles à accomplir la mission qui lui a été confiée.
Le HCRUN apathique, l’initiative de porter à l’agenda la question de la réconciliation est menée exclusivement par la Coalition pour la démocratie et la réconciliation (CODER) ; En moins d’un an d’existence elle a mené des concertations tous azimuts, sans que l’on ne voye jusqu’à présent poindre à l’horizon les prémices d’un quelconque cadre de débats. Il faut dire que l’activisme de la CODER sur le sujet de la réconciliation fait polémique. En effet, constituée pour l’essentiel de partis membres de la majorité déchue, cette coalition est fortement suspectée par une partie de l’opinion et surtout par des acteurs politiques majeurs qui voient dans son initiative une ruse et une prime à l’impunité. Pour autant, les comptenteurs de la Coder ne formulent pas non plus de contre-offre politique clairement énoncée de sorte que le statu quo demeure.
Réinventer un vivre-ensemble nouveau
Et pourtant, il faudra y aller. Car, si le Burkina n’a pas encore encore sombré dans ls pires atrocités vécues ailleurs, il faudra, une bonne fois pour toute vider tous les contentieux passés pour se projeter dans le monde.
Qui alors pour impulser la dynamique réconciliatrice au Burkina ? Roch Marc Christian Kaboré. Réputé pour être un homme consensuel, le Président Kaboré devra s’émanciper des faucons de son camp pour imprimer sa marque à la marche de la réconciliation qui fera de lui ou pas le Mandela du Burkina.
Si la vérité est un préalable indépassable sur le chémin de la réconciliation, il y a que son avènement par le truchement des procès classiques reste improbable. Pour les Burkinabè, il faudra imaginer des formes alternatives de manifestation de la vérité qui s’affranchissent des canaux traditionnels de la justice classique. Il faudra aménager un cadre pour que les accusés puissent confesser de leurs crimes.
La manifestation de la vérité permettra aussi la réalisation d’une autre étape incontournable pour la réconciliation : celle de la réécriture de la nouvelle histoire du Burkina et son enseignement à tous. Cette tâche incombera aux historiens professionnels dont l’intervention ne doit pas être guidée par la « manie du jugement » dont le but serait de cautionner tel ou tel point de vue mémoriel, mais pour éclairer les enjeux d’actualité, en donnant aux citoyens des éléments pour qu’ils jugent par eux-mêmes.
Plus qu’une justice de palais, le Burkina a besoin pour sa réconciliation d’une justice économico-sociale. Celle contre les inégalités entre les différentes régions du pays en termes d’investissements socio-économiques pour le développement. À cette condition, on pourra renouer le sentiment d’appartenance à la même Nation et étouffer dans l’œuf les révendications régionalistes et identitaires qui se font de plus en plus entendre.
Certes les signaux sont alarmants. Le Burkina n’a pas encore franchi la ligne rouge. Il devra s’y garder. Et cela dépend de tous. Et tous ont les moyens de perpétuer la communauté de destin forgée aux détours du hasard de la colonisation française pour en faire cette fois-ci un projet propre de vivre-ensemble voulu et de présence consciente au monde.